L’approche systémique : bien plus qu’une thérapie, une vision du monde
- Jeanne Coiffard Psychologue

- 23 mai 2025
- 4 min de lecture
Dernière mise à jour : 30 août 2025
1. 🔄 Une manière de penser le monde et les relations
L’approche systémique ne se résume pas à une technique psychothérapeutique : elle est avant tout une façon de penser les problèmes humains en contexte. Elle invite à observer les interactions, les logiques circulaires, les tentatives de résolution inefficaces, et les rôles que chacun adopte dans une dynamique relationnelle.
On ne s’intéresse pas à l’individu isolé mais au système dans lequel il évolue : famille, couple, institution, groupe. Le symptôme est perçu comme une réponse adaptative à un équilibre relationnel, et non comme une pathologie individuelle.
2. 🌐 Les origines de l’approche systémique : les trois grandes vagues
→ La première vague : la cybernétique (années 1950-70)
L’approche systémique est née aux États-Unis sous l’influence des travaux de Gregory Bateson, Don Jackson et Paul Watzlawick. Inspirée de la cybernétique, elle introduit la notion de boucles de rétroaction, de communication paradoxale et d’homéostasie relationnelle.
→ La deuxième vague : stratégie, structure, et action (années 1970-90)
Cette phase se caractérise par un tournant pragmatique. Des modèles opérationnels voient le jour :
La thérapie brève stratégique (MRI de Palo Alto, Giorgio Nardone).
L’approche structurale (Salvador Minuchin).
L’approche stratégique (Jay Haley, Cloe Madanes).
L’approche de Milan (Luigi Boscolo, Gianfranco Cecchin).
L’approche expérientielle symbolique (Carl Whitaker).
→ La troisième vague : co-construction, postmodernisme et ouverture à la subjectivité (depuis les années 1990)
Cette phase voit l’émergence de modèles plus coopératifs, non-directifs, centrés sur les ressources et le langage :
L’approche orientée solution (Steve de Shazer, Insoo Kim Berg).
La thérapie narrative (Michael White & David Epston).
Les approches dialogiques (Tom Andersen, Jaakko Seikkula).
Les approches multiréférentielles (Mony Elkaïm, Guy Ausloos).
3. 📊 Les grands principes de l’approche systémique
Voici quelques-uns des principes fondamentaux qui guident la pensée systémique :
L’observation circulaire : toute situation est analysée en termes de boucles d’interaction. Il n’y a pas de cause unique, mais un processus circulaire.
Le symptôme a une fonction : il est une tentative d’adaptation ou de régulation du système.
La responsabilité est distribuée : il ne s’agit pas de chercher un coupable, mais de comprendre les rôles que chacun joue dans une dynamique.
Le contexte prime sur l’intériorité : ce qui importe n’est pas ce que l’on pense ou ressent en soi, mais ce qui se passe dans l’interaction.
L’importance du langage et des croyances : les mots que nous utilisons construisent la réalité que nous vivons.
Ces principes sont développés dans plusieurs textes fondamentaux, notamment ceux présentés par Epsilonmélia (2024) et Meynckens-Fourez & Henriquet-Duhamel (2007).
4. 🏫 Des outils clés de l’approche systémique
Le questionnement circulaire (Ecole de Milan) : il permet d’explorer les interactions et représentations croisées. Exemple : "Que pense votre fille de la façon dont vous réagissez aux disputes ?".
La prescription de symptôme (Palo Alto) : stratégie paradoxale pour révéler le fonctionnement dysfonctionnel d’une tentative de résolution.
La réattribution des compétences (approche orientée solution) : mettre en lumière ce qui fonctionne déjà.
La déconstruction narrative (approche narrative) : interroger les "histoires dominantes" et les identités figées.
La sculpture familiale (Whitaker / Minuchin) : donner à voir les relations dans l’espace corporel.
L’utilisation de métaphores et récits symboliques (Whitaker) : accéder à la dimension émotionnelle de l’expérience.
5. 🎬 Julien Besse : rendre la systémie vivante, incarnée et accessible
Psychologue clinicien, thérapeute familial et formateur, Julien Besse défend une systémie créative, accessible, concrète et rigoureuse. Il met l’accent sur la posture du thérapeute comme personne engagée dans la relation, capable d’humour, de créativité et de réajustements.
Sur son site, il revendique une approche non dogmatique, nourrie de plusieurs influences systémiques (notamment Palo Alto, Milan, Elkaïm, Minuchin), et articulée autour de valeurs éthiques : respect, engagement, cadre clair, et conscience du pouvoir thérapeutique.
Ses formations, podcasts et vidéos illustrent cette volonté de transmettre une systémie ancrée dans la pratique, où l’on apprend à manier des outils mais aussi à penser le changement, la communication et la complexité des liens humains. Il invite à une auto-réflexivité constante du praticien, convaincu que c’est dans la position de recherche que se joue la justesse de l’intervention.
6. 📍 Centres ressources et pratiques cliniques vivantes
En France, certains Centres de Thérapies Familiales (CTF) sont intégrés à des services de psychiatrie publique, permettant un accès à la co-thérapie familiale sans frais pour les patients. C’est le cas notamment :
Du CTF de Montauban (Centre hospitalier)
Du CTF de l’hôpital Montperrin à Aix-en-Provence
Ces structures pratiquent généralement la co-thérapie, avec deux thérapeutes présents en séance, souvent issus de disciplines différentes.
✨ Si vous connaissez d’autres dispositifs similaires, n’hésitez pas à les partager en commentaire pour nourrir cette cartographie collaborative.
📅 En conclusion
L’approche systémique invite à penser le changement autrement : par l’observation des interactions, la prise en compte du contexte, et l’expérimentation de nouvelles manières d’être en lien.
C’est une approche qui donne des outils, mais surtout une façon d’être thérapeute. Une vision du monde.
📗 Références
Epsilonmélia. (2024). Approche systémique de Palo Alto : définition et principes. https://www.epsilonmelia.com/ressources-pedagogiques/approche-systemique-palo-alto-definition/
Meynckens-Fourez, M. & Henriquet-Duhamel, M.-C. (2007). Dans le dédale des thérapies familiales : Un manuel systémique. Éditions èrès. https://doi.org/10.3917/eres.meync.2007.03
Watzlawick, P., Weakland, J., & Fisch, R. (1975). Change: Principles of Problem Formation and Problem Resolution. Norton.
White, M., & Epston, D. (1990). Narrative means to therapeutic ends. Norton.
Minuchin, S. (1974). Families and family therapy. Harvard University Press.
Haley, J. (1976). Problem-solving therapy. Jossey-Bass.
Andersen, T. (1991). The reflecting team: Dialogues and dialogues about the dialogues. Norton.
.png)







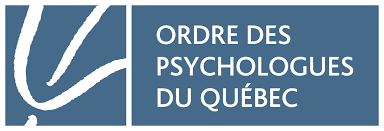
Commentaires