🎭 Le syndrome de l'imposteur : mieux le comprendre pour mieux le dépasser
- Jeanne Coiffard Psychologue

- 19 mai 2025
- 3 min de lecture
Dernière mise à jour : 30 août 2025

Cet article a été rédigé à partir du livre Surmonter le syndrome de l’imposteur de Kevin Chassangre (2024) et complété par plusieurs études scientifiques récentes.
Notre objectif : vous aider à mieux comprendre ce phénomène, ses racines, ses manifestations, et surtout vous donner des pistes concrètes pour le dépasser.
1. Définition, origines et signes du syndrome de l’imposteur
Le syndrome de l’imposteur désigne un phénomène psychologique où une personne, malgré des réussites objectives, se sent illégitime, attribuant son succès à des facteurs externes comme la chance, le hasard ou le soutien des autres【1】.
Quelques signes caractéristiques :
Douter systématiquement de sa légitimité.
Minimiser ses compétences malgré des preuves objectives de réussite.
Redouter d’être "démasqué" comme un imposteur.
Historiquement, le concept a été formalisé par Pauline Clance et Suzanne Imes en 1978【2】, qui avaient initialement observé ce phénomène chez des femmes à haute réussite.
🔎 À noter : Jusqu’à 70 % des individus expérimenteraient au moins une fois dans leur vie ce sentiment【8】.
Chez les étudiants, notamment dans les filières sélectives comme la psychologie ou la médecine, le syndrome est très fréquent【9】.
2. Racines profondes : d’où vient ce sentiment d’imposture ?
Le syndrome de l’imposteur ne naît pas du vide.
Il s'enracine dans :
L’histoire personnelle : un style éducatif perfectionniste, des attentes familiales élevées【4】.
La pression sociale : la valorisation extrême de la performance académique et professionnelle【9】.
Les appartenances sociales : les minorités culturelles, ethniques ou de genre y sont particulièrement exposées【11】.
De plus, certaines croyances auto-limitantes entretiennent ce cercle vicieux :
"Si c'était facile, c'est que ça ne vaut rien."
"Si je réussis, c'est que j'ai eu de la chance."
"Je dois tout savoir avant de me lancer"【4】.
3. Profils d’imposteurs et mécanismes d’entretien
Kevin Chassangre distingue plusieurs profils d’imposteurs【5】 :
Le perfectionniste : jamais satisfait de son travail.
Le superman/la superwoman : se surinvestit pour compenser son sentiment d'infériorité.
Le génie naturel : pense que tout devrait être facile du premier coup.
Le solitaire : refuse toute aide pour "prouver sa valeur".
L’expert : n’est jamais satisfait tant qu’il ne sait pas tout.
Chaque profil développe des stratégies d’évitement, des schémas de pensée erronés, et des réactions émotionnelles intenses (culpabilité, honte, anxiété)【6】【7】.
4. Comment dépasser le syndrome de l’imposteur ?
➡️ 1. Accepter et normaliser
Reconnaître que ce sentiment fait partie du parcours est un premier pas essentiel【7】.
Savoir que même des figures publiques ou des leaders éprouvent ces doutes peut être rassurant.
➡️ 2. Identifier ses distorsions cognitives
Travailler sur ses croyances limitantes : apprendre à distinguer ce qui est objectivement vrai de ce qui relève de l’autodévalorisation.
➡️ 3. S’autoriser l’imperfection
Sortir du perfectionnisme paralysant : se donner le droit d’apprendre, d’échouer, de ne pas tout maîtriser immédiatement.
➡️ 4. S’appuyer sur un accompagnement thérapeutique
La thérapie peut être une aide précieuse pour :
Explorer ses schémas familiaux et sociaux.
Déconstruire ses croyances inconscientes.
Renforcer l’estime de soi et la confiance en ses compétences【10】.
🎯 Si vous ressentez le besoin d’être accompagné(e) dans cette démarche, je propose des consultations d'orientation thérapeutique (COT) pour vous aider à trouver le bon accompagnement en fonction de votre profil et de vos besoins.
📚 Pour aller plus loin :
【1】【4】【5】【6】【7】Chassangre, K. (2024). Surmonter le syndrome de l’imposteur. Éditions Dunod.
Un guide accessible et structuré pour comprendre les origines du syndrome, identifier ses manifestations, ses profils types, les mécanismes qui l'entretiennent, et découvrir des outils concrets pour en sortir.
【2】Clance, P. R., & Imes, S. A. (1978). The impostor phenomenon in high achieving women: Dynamics and therapeutic intervention. Psychotherapy: Theory, Research & Practice, 15(3), 241–247.
L’article fondateur du concept, à l’origine de la notion de « syndrome de l’imposteur ».
【3】Clance, P. R. (1992). Clance Impostor Phenomenon Scale (CIPS). Traduction française : Chassangre, K. (2016).
Une échelle d’auto-évaluation permettant de mesurer le sentiment d’imposture.
【8】Gravois, J. (2007). You're not fooling anyone. The Chronicle of Higher Education, 53(11), A1–A7.
Une chronique marquante qui explore la présence du syndrome dans le monde académique anglo-saxon.
【9】Université de Lausanne (UNIL). (2023). Le syndrome de l’imposteur : un fléau sur les bancs de l’université. Uniscope.
Une enquête menée auprès des étudiant·es suisses sur la banalisation du syndrome de l’imposteur.
【10】Sakulku, J., & Alexander, J. (2011). The impostor phenomenon. International Journal of Behavioral Science, 6(1), 73–92.
Une revue scientifique qui synthétise les recherches sur le syndrome et ses conséquences psychologiques.
【11】Peteet, B. J., Montgomery, L., & Weekes, J. C. (2015). Predictors of impostor phenomenon among talented ethnic minority undergraduate students. The Journal of Negro Education, 84(2), 175–186.
.png)







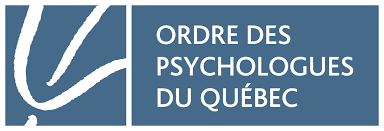
Commentaires